 Journal of the
Slovene Association of LSP Teachers
Journal of the
Slovene Association of LSP TeachersISSN: 1854-2042 |
 |
Home | Call
for Papers | Submissions | Journal Info | Links | |
Mojca Jarc
Vers une approche fonctionnelle de l'enseignment de la terminologie: Action recherche en classe de Français
ABSTRACT
The purpose of the paper is to study different parameters in terminology teaching within the framework of a French language course offered at the Faculty of Social Sciences (FSS) in Ljubljana, in order to better integrate the theoretical developments in the field of descriptive terminology with the teaching practice of French for specific purposes (FSP).
The results of an action research carried out in a group of students of social sciences suggest that the theoretical solutions applied for glossary compilation, and the use of terminological record sheets to describe terms cannot be viewed as automatically transferable into the classroom practice, and that consequently, each classroom situation has direct implications for the use of terminological record sheets in terminology teaching, which calls for adapted solutions, based on the functional approach to teaching foreign language for specific purposes.
RÉSUMÉ
L'article se propose d'étudier les différents paramètres de l'enseignement de la terminologie dans le cadre du cours de Français langue étrangère à la Faculté des Sciences Sociales de Ljubljana (FSS) afin de jeter des ponts entre l’évolution de théorie dans le domaine de la terminologie descriptive et la pratique de l’enseignement dans un contexte du cours de français sur objectifs spécifiques (FOS). Les résultats d’une action recherche menée au sein d’un groupe d’étudiants en sciences sociales montrent que les solutions théoriques pour la constitution de glossaires thématiques ne sont pas automatiquement transposables dans la pratique pédagogique et que des solutions adaptées, axées sur une approche fonctionnelle s’imposent dans une classe de langue étrangère.
© 2006 Scripta Manent. Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.
Introduction
Même si la notion est difficile è définir (Gaudin : 2003), la terminologie est généralement reconnue en tant que l'un des éléments constitutifs de la langue de spécialité, car elle permet l’identification et la structuration d’une communauté discursive. Pour un professeur de langue une question importante ressort face à de nombreuses recherches théoriques dans le domaine de la terminologie descriptive, à savoir : Comment faire le lien entre ce savoir d'une part et la réalité de la pratique pédagogique d'autre part afin d'introduire la notion d'analyse terminologique dans une classe de langue? Les questions de ce genre resurgissent probablement dans la préparation de chaque cours de langue de spécialité. Partant de l'idée qu'il faut trouver les réponses adaptées à des situations concrètes et au contexte local nous avons retenu la méthode de recherche active, car cette approche permet de mieux définir le cadre général de l’action et d'avancer vers une solution possible.
Le contexte local
Afin de mieux connaître les enjeux de la situation particulière on doit donc examiner de plus près les éléments qui façonnent le cursus et l'enseignement à la FSS. Deux logiques s'enchaînent ici: la logique de l'enseignement du français de spécialité pour un public des étudiants en voie de spécialisation (études du 2e cycle) et la logique de l'enseignement basé sur la théorie socioconstructiviste.
Le français sur objectifs spécifiques
Les langues étrangères sont considérées comme un atout important pour les futurs diplômés de la FSS de Ljubljana. Le français est l'une des six langues étrangères offertes par la faculté. Le cours de français s'adresse aux étudiants, qui souhaitent approfondir leurs connaissances de langue générale avec les éléments de la langue de spécialité. La nature de ce cours s'explique par un besoin d'intégrer l'apprentissage de langues étrangères dans le cursus général des apprenants ainsi que par leurs objectifs professionnels et les exigences du marché de travail, ce qui présuppose une analyse préliminaire des besoins des apprenants en fonction de leur profil, à savoir : leurs compétences langagières, niveau de connaissances spécialisées, motivations, projets d’études et objectifs personnels. Les résultats de cette analyse permettent d'identifier une difficulté fondamentale, notamment une forte hétérogénéité du groupe en ce qui concerne tous les paramètres mentionnés.
L’approche pédagogique adoptée
Deux facteurs ont fortement influencé notre décision sur l’approche pédagogique pour le cours du français : l’intégration et le transfert des apprentissages des »matières de base« dans l’enseignement de la langue étrangère. Selon Guilbert & Ouellet (2004 : 14) ces deux exigences se trouvent parmi les principes directeurs de l’approche socioconstructiviste. Le questionnement sur le choix des méthodes était donc naturellement dirigé vers l’étude de cas et l’apprentissage par problèmes (APP). Ces méthodes sont marquées par une forte composante pédocentrée et sociocentrée.
L'enseignement de la terminologie dans un programme du cours de français
S’il est généralement admis que la terminologie est une clé de voûte de la langue de spécialité, les moyens d’intégration du lexique spécialisé dans une classe de FOS sont moins clairement définis. Les débuts du FOS étaient fortement marqués par l'exploration des listes de terminologie, même si les critiques de cette approche se faisaient entendre. Dans les années 1990 Sophie Moirand avertissait contre le réductionnisme simpliste des contenus »en termes d'unités minimales de communication et de signification« (citée dans Sagnier : 2004). Graduellement l’évolution de la discipline a montré des tendances vers une autonomie augmentée de l’apprenant. C’est dans cette optique que Odile Challe (2002) propose un cadre d’apprentissage adapté à l’apprenant spécialiste en passant en revue les différentes possibilités d’aborder la langue, y compris l’approche terminologique. Selon elle, cette approche permet de perfectionner les compétences linguistiques de l’apprenant en utilisant les méthodes de l’analyse sémantique. De même, Christine Sagnier (2004) préconise la pédagogie de projet dans le français des affaires sans pour autant préciser quelle est la place du lexique de spécialité dans cette approche.
Suivant les choix méthodologiques opérés pour notre cours de français, nous avons décidé d’intégrer l'enseignement de la terminologie dans le cycle APP.
Or il s’est révélé au terme du cycle que les résultats du travail à visée terminologique n’étaient pas toujours satisfaisants.
A partir de ce constat on s'est fixé deux objectifs: premièrement recentrer l'enseignement de terminologie dans le cours de FOS, deuxièmement introduire une méthode pédocentrée de l'apprentissage de terminologie au sein de notre cours.
Méthode de recherche
La méthode d'action recherche (AR) semblait particulièrement appropriée à la situation d'enseignement à la FSS. Le choix de la méthode de recherche a été motivé par le contexte particulier de l’enseignement. Selon Pike (2002) l'AR est une méthode qui redéfinit l'opposition entre le sujet le l'objet. Le chercheur étant le sujet ainsi que l'objet de la recherche, il crée constamment un lien entre la théorie et la pratique. Cette approche part de la situation réelle pour aboutir à des conclusions généralisables. Elle est souvent associée au changement social en général (Curry 2005) et à l'enseignement en particulier (Altricher et. Al, 1993. p. 201). Dans le cas étudié elle implique l'intégration de l'enseignant en tant que chercheur et professionnel et des étudiants en tant que communauté recherchée, voire l'élimination de distinction entre l'enseignant de langue et l'apprenant.
La recherche passe par plusieurs étapes fondamentales, notamment l'observation et la description de la situation-problème, l'analyse, l'évaluation et interprétation de la situation, et la proposition des solutions au problème. La finalité de cette démarche est donc de déceler les raisons des problèmes rencontrées par les utilisateurs et d’apporter des réponses à ces problèmes.
Déroulement
Observation et description
Au début de la recherche il convient de décrire brièvement le contexte de notre situation-problème. Dans notre cours de français, l'enseignement de la terminologie fait partie du cycle APP (pour un parcours typique APP voir Tableau 1). La question de la terminologie intervient tout au long de ce cycle, mais elle devient particulièrement pertinente au moment de la préparation d’un rapport écrit, dans lequel les étudiants présentent les solutions au problème abordé.
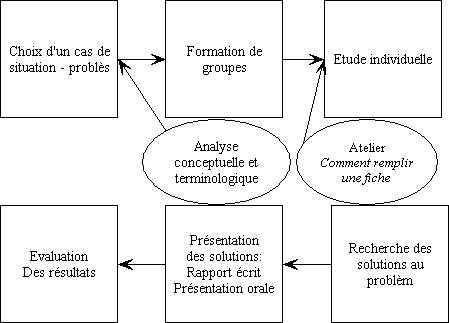
Tableau 1 : L’intégration des activités terminologiques dans un parcours APP typique
L’une des tâches au sein du projet APP consiste à constituer une ébauche de quelques fiches terminologiques rédigées à la base des textes utilisés lors de la préparation du projet. Ces fiches figurent en annexe du rapport.
Pour initier les étudiants aux techniques de la préparation et de la présentation du projet plusieurs ateliers sont intégrés dans ce cycle, dont un atelier titré Comment remplir une fiche terminologique? L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les étudiants à l’observation et à la description de la terminologie.
L’activité de l’atelier est divisée en plusieurs phases. L’atelier s’ouvre par une phase de conceptualisation permettant l’identification de la terminologie. Dans cette optique il faut tout d'abord introduire la notion de l'unité terminologique. L’unité terminologique est ensuite comparée à l’unité lexicale.
La deuxième phase vise l’observation et l’analyse. Afin de permettre l'exploration des champs terminologiques on a choisi de proposer aux étudiants les outils permettant la description de la terminologie. Depuis les années 1980 de nombreux modèles de fiche terminologique ont été proposés. Notre fiche terminologique est une adaptation de fiches élaborées par CTN (Lerat : 1988) et par Bowker & Pearson (2002 : 143).
| FICHE TERMINOLOGIQUE-
LÉGENDE FRA: vedette en français GRA classe grammaticale DOM: domaine de la notion SDO: sous-domaine de la notion DOA: domaine d’application DEF: définition (de dictionnaire: 1 phrase) CON: contexte, attestation d’emploi (copier la phrase, dans laquelle le terme est employé) SOU: source (du terme, de la définition, du contexte) SYN: synonyme SLO: équivalent slovène NOT: note (renseignement de type encyclopédique) COM: combinaison syntaxique, collocation SOR: sorte de (terme générique) PAR: partie de (élément, composant de...) ARG: argument (object(s) connexe (s)) RED: rédacteur de la fiche MAJ: date de la dernière mise à jour |
Tableau 2: Format de fiche terminologique
L’activité de l’atelier se termine par une synthèse, au cours de laquelle les principes de rédaction de fiche terminologique sont généralisés.
Les étudiants peuvent ensuite procéder à la phase du travail autonome, notamment l'analyse de la terminologie au sein du projet APP choisi. Dans ce travail les étudiants font référence à leurs connaissances conceptuelles. Par ailleurs, ils utilisent des dictionnaires et des encyclopédies spécialisées, des banques terminologiques et procèdent au dépouillement des textes utilisés pour la préparation du rapport final. Il s’agit d’un travail en équipe, qui est réalisé en dehors de la classe.
L’analyse des résultats de ce travail a montré que:
- selon les étudiants les fiches terminologiques figuraient parmi les parties les plus difficiles du projet;
- les étudiants avaient du mal à identifier les termes;
- les résultats du travail terminologique n’étaient pas toujours satisfaisants.
Se pose donc la question suivante: Comment améliorer la pratique existante de l'enseignement de la terminologie?
Pour répondre à ce défi nous tentions en premier lieu de repérer les difficultés méthodologiques et conceptuelles de la démarche pédagogique, et en deuxième lieu d’adapter l’action pédagogique aux besoins des étudiants.
Analyse, évaluation et interprétation de la situation
Afin d'approfondir notre compréhension du contexte et de l'ampleur du problème, et pour identifier également les autres facteurs qui peuvent être impliqués, un questionnaire a été développé à la base des questions relatives à la fiche terminologique existante. Les questions étaient formulées d'une manière collaborative par l'enseignant les apprenants.
| FICHE TERMINOLOGIQUE
– QUESTIONNAIRE Evaluez vos réponses en donnant des cotes de 1 (non) à 5 (oui). |
| 1. Est-ce que la
tâche est perçue comme pertinente par les
étudiants? 2. Pourquoi? 3. Est-ce que la tâche est difficile? 4. Est-ce que les instructions sont compréhensibles? 5. Est-ce que les instructions sont trop complexes? 6. Combien de connaissances préliminaires sont nécessaires pour l’accomplissement de la tâche? 7. Est-ce que les connaissances linguistiques des apprenants sont suffisantes pour l’accomplissement de la tâche? 8. Est-ce que les connaissances conceptuelles des apprenants sont suffisantes pour l’accomplissement de la tâche? 9. Est-ce que les apprenants peuvent consulter d’autres sources pour l’accomplissement de la tâche? Lesquelles? Est-ce que les apprenants connaissent ces sources? 10. Est-ce que les apprenants utilisent l’aide de l’enseignant? 11. Combien de temps vous avez dédié à cette tâche? 12. Quels sont les avantages /désavantages de ce type de travail? 13. Quels sont les changements principaux qu'il faudrait opérer pour optimiser l'apprentissage de la terminologie? 14. Quelles sont vos suggestions pour les changements spécifiques du formulaire? |
Tableau 3: Questionnaire
Les questions ont ensuite été regroupées afin de permettre une meilleure analyse.
Les questions visaient à traiter les paramètres suivants : le contexte général, la nature de la tâche, le niveau de connaissances linguistiques des apprenants, le niveau de connaissances conceptuelles des apprenants, le rôle de l’enseignant et les suggestions pour les changements.
L'analyse des questionnaires a démontré plusieurs failles dans l’intégration de l’analyse terminologique dans le cycle APP ainsi que dans la conception de certaines activités. Premièrement, le contexte de la tâche de description terminologique devrait être mieux défini, notamment en ce qui concerne les objectifs pédagogiques, les habiletés, les connaissances, les attitudes et le mode d’évaluation.
Deuxièmement, la tâche n’était pas adaptée aux compétences linguistiques et conceptuelles divergentes des apprenants, ce qui entraînait une sorte de confusion en ce qui concerne les résultats escomptés. En principe tous les étudiants reconnaissaient que l’analyse terminologique était utile, mais ils n’étaient pas d’accord sur sa portée dans l’apprentissage de la langue de spécialité. L’activité descriptive n’était pas toujours perçue comme pertinente par les étudiants, car elle demandait trop de travail sur les détails que les étudiants ne comprenaient pas toujours. Par conséquent, les étudiants se plaignaient aussi de la complexité de la fiche terminologique et des instructions pour le travail terminologique. Les étudiants ayant un niveau de langue relativement avancé étaient plus motivés par ce genre de travail, alors que les étudiants ayant un niveau plus faible montraient moins d’intérêt pour la tâche. Même les apprenants dont le niveau de compétences linguistiques était relativement élevée considéraient qu’ils ne possédaient pas toujours les connaissances conceptuelles suffisantes pour accomplir la tâche.
Troisièmement, en ce qui concerne le rôle de l’enseignant, la majorité des étudiants ont reconnu avoir trop rarement consulté l’enseignant pendant la rédaction des fiches terminologiques.
Enfin, les étudiants n’ont pas proposé de changements explicites relatifs au processus de l’apprentissage de la terminologie. Par contre, une simplification radicale du formulaire a été souhaitée par la quasi-totalité des répondants.
Les résultats de cette analyse ont été présentés aux étudiants. Après la présentation, une discussion a été organisée, dans laquelle un consensus a été acquis sur une révision générale de l’approche en ce qui concerne la présentation et le traitement de la documentation terminologique aussi bien que les critères d’évaluation du produit finale (i.e. la fiche terminologique).
Proposition des solutions au problème
Face à ces résultats un certain nombre de changements s’imposait en vue d’améliorer le niveau de connaissances acquises par l’exercice de la description terminologique. Ces changements passent par les étapes suivantes:
- La redéfinition des objectifs de l’analyse terminologique;
- Le repositionnement de l’activité de description terminologique dans le programme du cours afin de mieux initier les apprenants à l’analyse;
- La diversification des tâches en fonction des connaissances linguistiques et conceptuelles des étudiants;
- Le renforcement de la coopération entre l’enseignant et les étudiants au cours de l’accomplissement de la tâche;
- La simplification de la fiche terminologique;
- La promotion du partage des résultats du travail terminologique effectué dans le groupe;
- L’introduction des protocoles visant la description du déroulement de l’activité terminologique;
- L’introduction de l’auto-évaluation.
Résultats
Ces réorientations ont apporté deux éléments significatifs qui ont contribué à un changement de l’attitude des apprenants envers la terminologie, notamment la responsabilisation des apprenants et l’amélioration de la discussion.
Responsabilisation augmentée des étudiants pour le principe organisationnel appliqué dans la description de la terminologie
Le processus en soi s'est révélé valorisant pour tous les participants. Le dialogue qui s'installe dans cette approche permet une réflexion critique, une discussion sur les différents aspects de la terminologie, la mise en commun des connaissances, d'expériences et de compétences dont la portée dépasse largement le concept de l'enseignement traditionnel de langues étrangères. Les étudiants ont collaboré pleinement dans la recherche du modèle convenable, car ils se sentaient responsables pour le résultat final.
Amélioration de la discussion sur la terminologie
Le processus mène vers l’évolution des compétences importantes dans la vie professionnelle des apprenants, à savoir l’intégration et le transfert des apprentissages et le développement des habiletés interpersonnelles. Il vise par ailleurs à développer les habiletés procédurales et stratégiques. La qualité de la discussion sur la terminologie a été accrue. Les étudiants ont témoigné de l’intérêt surtout dans le domaine de la recherche des définitions des termes.
Or ce principe organisationnel n’est pas une panacée, car il comporte quelques limites importantes. Premièrement, il semble que le changement d’approche ne peut pas exercer une influence positive sur la motivation de tous les étudiants. Malgré les efforts de l’enseignant certains étudiants n’ont pas témoigné beaucoup d’intérêt pour la question traitée. Ensuite, on peut se poser aussi la question sur l’économie d’une telle démarche dans une situation de classe confrontée à de sérieuses contraintes de temps. Enfin, la complexité de la tâche s’est révélée trop grande pour les apprenants ayant un niveau de langue relativement faible.
Les questions principales qui se dégagent des résultats de cette recherche sont:
-
Quels sont les lacunes linguistiques et conceptuels les plus
caractéristiques des apprenants?
- Comment apporter des solutions individualisées pour le traitement de la terminologie en fonction des niveaux de langue différents des participants?
- Comment apporter des solutions individualisées pour le traitement de la terminologie en fonction des niveaux de langue différents des participants?
Enfin, les résultats de notre recherche laissent supposer que pour nos étudiants le travail sur la terminologie devrait largement être complété par le travail sur le vocabulaire général.
Conclusion
Etant donné que l'AR est typiquement un processus cyclique ou spirale, qui aboutit par définition à une nouvelle action suivie d'une réflexion, notre travail futur portera sur l'amélioration des connaissances sur les principes d'acquisition et de maîtrise de la terminologie, ce qui devrait mener vers un raffinement des méthodes d'apprentissage de la terminologie dans la langue étrangère.
Bibliographie
Altricher, H., Posch, P. & Somekh B. (1993) Teachers Investigate their Work. An introduction to the Methods of Action Research. London: Routledge.
Bowker, L., and Pearson, J. (2002) Working with Specialised Language. A practical guide to using corpora. London : Routledge.
Challe, O., (2002) Enseigner le français de spécialité. Paris : Economica.
Curry, A. (2005) L'action recherche en action : l'implication des étudiants et des professionnels, (online). Available: http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/046f_trans-Curry.pdf (24.2.2006).
Gaudin, F. (2003) Socioterminologie. Une approche sociolinguistique de la terminologie. Bruxelles : De Boeck. Duculot.
Guilbert, L. and Ouellet L. (2004) Etude de cas. Apprentissage par problèmes. Le Delta I : Presses de l’Univeristé de Quebec.
Lerat, P. (1988) Terminologie et sémantique descriptive. La Banque des mots (numéro spécial), 11-38.
Pike, M.A. (2002) Action research for English Teaching. Educational Action Research, 10 (1), 27-44.
_____
© The Author 2006. Published by SDUTSJ. All rights reserved.
Scripta Manent 2(1)
» S.
Laviosa and V. Cleverton
Learning
by Translating: A Contrastive Methodology for ESP Learning and
Translation
» M. Jarc
Vers
une approche fonctionnelle de l'enseignment de la terminologie: Action
recherche en classe de Français
» V. Jurković
Vocabulary Learning Strategies in an ESP Context
Other Volumes